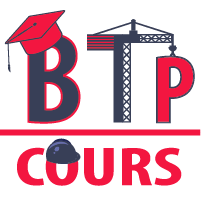Depuis les années 1970 et la publication des actes du congrès de Besançon (1973) (1) ou de l’enquête sur l’industrie du bâtiment dirigée par Pierre Chaunu (1971) (2), le regain d’intérêt des historiens du bâti pour les sources écrites s’est trouvé constamment relancé et soutenu, en France comme dans le reste de l’Europe, par un nombre croissant de travaux universitaires ou autres. L’étude de l’architecture domestique ou « vernaculaire » a, dans ce domaine, joué un rôle majeur prenant alors, en quelque sorte, le relais des classiques recherches conduites sur les églises et les châteaux médiévaux à partir des chroniques ou des comptabilités. Se livrer à une comparaison des démarches suivies dans ces deux domaines nous entraînerait un peu loin du thème retenu pour cette rencontre, et je me contenterai, pour introduire mon propos, de constater l’importance de l’apport des textes à notre connaissance de la maison médiévale à travers le fait, par exemple, que plus d’un tiers (35 sur 103) des Cent maisons médiévales présentées sous la direction d’Yves Esquieu et de Jean-Marie Pesez en 1998 nous soient connues par des textes (3), ou que plusieurs des contributions du premier tome de La maison au Moyen Âge dans le Midi de la France, reposent spécifiquement sur des études d’archives (4).
L’évolution la plus récente a eu pour effet, avec le développement de la pluri- ou interdisciplinarité, de confronter des questionnements et, partant, de mettre en évidence de manière particulièrement nette les limites d’une approche uniquement textuelle du bâti – c’est-à-dire, en d’autres termes, des filtres que l’écrit interpose entre le chercheur et ce que l’on pourrait désigner comme la réalité des chantiers (5).
Le propos de la présente contribution n’est pas d’envisager ces limites dans leur ensemble mais de s’intéresser, plus particulièrement, à l’un de ces filtres: la terminologie technique méridionale. Divers exemples provençaux des derniers siècles du Moyen Âge nous permettront, en premier lieu, d’aborder la question du rapport entre la source et le vocabulaire ou, en d’autres termes, de la cohérence de l’ensemble constitué par un texte. Dans un second temps, les mots eux-mêmes seront considérés en tant que signes conventionnels, dont on peut rechercher le ou les sens, puis dans leur dimension historique, comme des témoins ou des sources à part entière.
Table of Contents
Sources médiévales et vocabulaire technique
Il semble important,tout d’abord, de revenir sur le statut de nos sources et sur leur supposée portée technique, afin de chercher à apprécier le choix terminologique fait par les scribes. Prenons comme point de départ l’analyse rapide d’un texte parmi des milliers d’autres: un contrat de construction ou « prix-fait » passé à Avignon le 19 janvier 1447 (6). Cet acte se présente comme une convention des plus banales, pour la Provence médiévale, tant dans son objet (la réfection partielle d’une maison) que dans sa forme (un contrat de quelques pages et d’une petite dizaine de clauses). C’est précisément à ce titre qu’il a paru pouvoir servir de support à une approche des dispositions contractuelles relatives à une construction.
Ce prix-fait envisage les travaux à faire dans la maison du notaire Antoine Agulhat (Agulhatii) par un certain Jean François (Francisci), désigné comme tailleur de pierre (lapiscida) originaire du diocèse de Genève et habitant d’Avignon. Le contrat peut se résumer comme un engagement à bâtir plusieurs portes, un mur, un chaînage et des piliers, dans une demeure préexistante, entre le 19 janvier (date de rédaction de l’acte) et le 24 juin (date de la fête de saint Jean-Baptiste) 1447, pour le prix de 15 florins, matériaux non-compris.
L’acte est formé d’un préambule précisant la date, le nom des intervenants et l’objet du contrat: « édifier et réparer la maison [d’Antoine Agulhat] » (edifficare et reparare domum suam). Viennent ensuite six paragraphes détaillant ces travaux, puis trois autres réglant la question des délais et du paiement de la prestation. Puis, nous trouvons la corroboration de l’acte avec souscription du notaire et de quatre témoins. Enfin, une cancellation, en date du 18 novembre de la même année, atteste la réalisation des travaux.
Comment le chantier nous apparaît-il à travers cette source?
Tout d’abord, il faut noter que le dispositif de l’acte, ce qui en forme le cœur et où se trouvent exposées les décisions prises, n’est que partiellement constitué de clauses relatives à la construction. Sur neuf Item, seuls six envisagent à proprement parler des travaux. Ils évoquent, en effet, respectivement:
- les portes de la boutique (facere portas appothece dicte domus, a parte anteriori, altitudinis et latitudinis secundum quod partes contrahentes inter se convenerunt, cum lapidibus, cemento et matheria per dictum magistrum Anthonium Agulhatii expendiendis) ;
- une porte sur l’arrière (aliam portam, a parte retro, altitudinis septem palmorum et latitudinis secundum quod eidem magistro Anthonio videbitur) ;
- une chaîne d’angle, un mur et un « pilier » (quantonum et totum parietem, a dicto quantono usque ad tinalem inclusive, et solerium aule sive sale et, a dicto solerio usque ad tectum, pillaria, tam de et super dicto quantono quam a parte dicti tinalis, neccessaria) ;
- un autre « pilier » (pillarium usque ad tectum de et super porta superiori introytus ipsius domus, a parte hospitii Johannis Turnerii, ad dictamen et ordinationem sapientum) ;
- l’étaiement de la maison (domum predictam retinere) et la fourniture des matériaux, à la charge du commanditaire (tradere eidem magistro Johanni lapides, cementum et totam matheriam circa hoc neccessariam et opportunam) ;
- l’enlèvement des déblais (dictos lapides restantes incontinenti facto edificio portare seu portari facere et transmutare, ne impediant carreriam publicam nec domum eiusdem magistri Anthonii aliquo modo).
Les trois clauses restantes, qui occupent à elles-seules deux des trois pages du contrat, concernent:
- les délais d’exécution et le prix des travaux (5 mois et 15 florins);
- la permission pour le constructeur de récupérer toutes les pierres de l’ancienne bâtisse contre un à valoir de 5 florins sur le prix des travaux;
- les modalités de versement des 10 florins restants et les dispositions pénales d’usage.
Si les clauses techniques existent et introduisent même le texte, elles apparaissent secondes si l’on considère leur développement ou la place qu’elles occupent au regard de l’ensemble. La fonction première de l’acte – désigné d’ailleurs comme prix de l’œuvre (pretium operis) – est, on le voit bien, de fixer les termes de l’échange et d’en assurer le respect. Cela explique – et c’est le deuxième point sur lequel il faut insister – que les dispositions relatives au bâti soient aussi laconiques. Prenons l’exemple de la première clause:
« Et premièrement, que ledit maître Jean [le maçon] soit tenu et doive faire les portes de la boutique de ladite maison, sur le devant, de la hauteur et largeur convenues entre les parties contractantes, et avec les pierres, le mortier et les matériaux fournis par ledit maître Antoine Agulhat ».
(Et primo, quod dictus magister Johannes teneatur et debeat facere portas appothece dicte domus, a parte anteriori, altitudinis et latitudinis secundum quod partes contrahentes inter se convenerunt, cum lapidibus, cemento et matheria per dictum magistrum Anthonium Agulhatii expendiendis.)
Il est clairement fait mention, ici, d’arrangements (touchant aux dimensions de la porte) qui n’ont pas été consignés dans l’acte mais font l’objet d’un accord verbal annexe, en quelque sorte (quod partes contrahentes inter se convenerunt). Il faut bien alors en conclure que toutes les décisions relatives au chantier, prises par les parties, n’étaient pas développées dans l’acte notarié. Ce dernier pouvait renvoyer de manière plus ou moins explicite à d’autres conventions: des accords oraux mais également des dessins, des actes sous seing privé, un exemple ou, plus simplement, la coutume.
Le prix-fait, en ce qui concerne le chantier, ne doit ainsi pas être considéré comme une source isolée, finie ou autonome. L’objet de l’acte officiel n’étant pas de fixer le détail de la construction mais de donner une valeur juridique à la convention, les rédacteurs se contentent bien souvent de dispositions très larges, englobant tout ce qui d’une manière ou d’une autre a pu être arrêté entre les parties, s’assurant par des formules du type « bien et dûment » ou « au dit de maîtres » – exaspérantes pour l’historien – de la qualité ou de la conformité des travaux.
Le recours à l’oral et au dessin comme la référence à la coutume mettent, par ailleurs, en évidence la difficulté que pouvaient rencontrer les notaires à rendre par écrit le détail d’un chantier. Le vocabulaire employé présente ainsi un caractère a priori généraliste qui tranche avec la destination technique que l’on prête habituellement à ces textes. Les actions sont simplement désignées par les verbes faire (facere), réparer (reparare), édifier (edifficare), porter (portare, transmutare) et retenir (retinere). Une douzaine de mots permettent de nommer les différents bâtiments ou parties de bâtiment concernés par les travaux: maison (domus, hospitium), porte (porta), boutique (apotheca), chaîne d’angle (quantonum), mur (paries), toit (tectum), pilier (pillarium), entrée (introytus), salle à manger (tinal), étage ou plancher (solerium),salle (aula). Quant aux matériaux, le scribe ne se sert pour les désigner que des termes pierre, mortier et « matière » (lapis, cementum, matheria).
Le corpus lexical est, dans ce cas, réduit à une vingtaine de mots, ce qui est peu par rapport à d’autres prix-faits mais rend compte, de manière un peu accentuée, de la pauvreté terminologique de ces documents pris individuellement. Les mots employés n’apparaissent pas, à première vue, issus d’un vocabulaire à proprement parler technique, mais dans l’état actuel de nos connaissances sur le monde de la construction médiévale, nous aurions tort de ne pas prêter attention aux choix faits par le notaire ou les parties.
Le mot comme signe conventionnel
S’il ne faut pas attendre d’une convention avant tout marchande qu’elle nous fournisse les mêmes éléments qu’un devis détaillé,si le prix-fait n’est pas un document technique pour hommes de l’art, ce type de sources nous renseigne néanmoins sur la vision qu’une partie de la population pouvait avoir d’un bâtiment. L’efficacité juridique de ces actes réside, en effet, dans leur intelligibilité et dans une relative précision du vocabulaire, qu’il convient de ne pas évacuer par des traductions trop rapides. Attardons-nous un peu sur ces mots et, en premier lieu, sur les questions que peut poser la restitution de leur sens.
Passons sur les variations de graphies qui peuvent, dans certains cas, compliquer l’identification d’un mot. Nous nous trouvons généralement face à un ensemble de termes dont le sens est à restituer. Les études d’archives se sont accompagnées dans bien des cas de la publication de lexiques ou d’index des termes techniques, qui facilitent ce type de recherches et peuvent pallier certaines des lacunes des grands dictionnaires de latin ou, dans le cas qui nous intéresse, de provençal. Ces lexiques nous donnent « des éclaircissements sur le sens des mots et des pistes de traduction » (7) indispensables mais qui, par leur brièveté même, ne permettent pas au lecteur d’apprécier le sens particulier que peut revêtir le mot à la date, dans le lieu et dans la situation précise où le notaire l’a employé. Et ceci d’autant plus que les lexiques ont tendance à se nourrir les uns les autres; la définition d’un terme étant souvent donnée par référence à d’autres lexiques plus ou moins proches, voire à des dictionnaires établis à partir de sources parfois très éloignées de celle considérée.
La démarche induit une imprécision qui n’est pas toujours imputable au scribe lui-même. Elle présente surtout l’inconvénient de paraître dispenser de partir des sources et, nivelant en quelque sorte les usages, nous prive d’apprécier les éventuelles inflexions de sens qu’un terme a pu connaître en fonction, encore une fois, du lieu, de l’époque ou du contexte dans lequel il est employé.
Le sens même des mots les plus anodins ou à la signification apparemment la plus évidente mérite parfois que l’on s’y arrête. Il semble ainsi possible, à l’examen de la convention de 1447, de proposer de traduire le mot latin matheria non par « matière » – ce qui n’est pas un contresens mais apparaît comme une facilité et donne au texte une pesanteur certaine – mais par « bois de construction », suivant un sens attesté déjà chez les auteurs de l’Antiquité comme Columelle ou Cicéron. Cette proposition de traduction rend un peu plus de logique à l’énumération de matériaux; le bois, non-évoqué, étant indispensable à la confection des cintres des baies comme à l’échafaudage ou à l’étayage des façades. Quant à l’usage de cette acception du mot dans le Midi médiéval, nous en trouvons une attestation dans un document concernant les forêts du Briançonnais, en 1378, et évoquant « une certaine quantité de « matière » (mayeria) ou bois qu’[un individu] puisse couper et faire couper dans les forêts » (certam quantitatem mayerie seu lignorum quam posset cindere et cindi facere in nemoribus) (8).
Un mot peut également présenter, localement, un sens particulier qui peut parfois se retrouver par recoupement de différentes sources proches. C’est ce que permet d’illustrer, par exemple, le cas du terme pillarium.
Le vocable n’est pas attesté sous cette forme dans les lexiques latins qui ne retiennent que pila ou pilare, is. Son originalité laisse à penser que le notaire, ignorant la variante pilare, a alors eu recours, pour désigner une partie de la maison projetée, à un mot latinisé à partir du provençal pilar. Pilar, comme pilare, désigne d’après Frédéric Mistral, qui donne les formes piela, piala, pila et piliè, « un pilier ou appui » (9).
Ce mot peut, et doit sans doute, être alors entendu dans le sens de « support soutenant une construction » mais, si l’on se réfère au Vocabulaire de l’architecture édité sous la direction de Jean-Marie Pérouse de Montclos, il s’agit d’un « support vertical dont le corps a un plan massé [qui] peut avoir une base et un chapiteau » (10). Nous avons alors un peu de mal à nous représenter à quoi pouvaient ressembler les « piliers » à réaliser dans la maison d’Antoine Agulhat.
Un dictionnaire encore inédit, compilé probablement à l’Isle-sur-la-Sorgue vers le milieu du XVe siècle, apporte un premier élément de réponse dans la définition qu’il donne du mot latin Stipes: « un élément long et solide qui soutient toute la maison et est fait de bois ou de pierres [en provençal] pilar » (est strumentum longum et firmum quod sustinet totam domum et est ligni vel lapidis, scilicet pillar) (11). Mis en relation avec la chaîne d’angle évoquée par le contrat, nous pouvons sans trop de risque y voir une jambe ou chaîne verticale placée dans le cours du mur suivant un parti-pris constructif encore observable dans divers bâtiments en élévation, notamment à Avignon.
L’attention portée à un vocabulaire a priori bien entendu permet, on le voit, non de rendre le texte d’une limpidité totale mais au moins de ne pas créer artificiellement une confusion qui n’a rien de médiéval. Cet exemple ne fait que souligner l’utilité ou la nécessité d’une analyse globale et sérielle du vocabulaire à une échelle réduite (régionale voire micro-régionale) pour tirer le meilleur parti des sources consultées (12).
Les mots peuvent être ainsi envisagés en tant que signes conventionnels dont il nous faut chercher à saisir et à restituer avec le plus de finesse possible le ou les sens afin de limiter les pertes d’information. Mais ces signes ne sont pas inertes et recèlent parfois une dimension historique qui fait d’eux des témoins ou des sources à part entière.
Les mots comme sources
Abandonnons, à présent, le prix-fait de 1447 pour prendre un exemple à peu près contemporain, celui de l’usage du mot postatus entre les XIII e et XVe siècles en Provence occidentale. Ce mot, formé sur le provençal post et la forme latine ou latinisée postis (planche), désigne une construction en planches. Mistral donne au terme poustat les sens de « plancher,soupente, cloison ». Mais le nom de postatus peut également être employé pour une façade de maison construite en planches, une sorte de pan de bois, généralement en encorbellement. C’est, par exemple, ce que l’on constate dans un texte avignonnais de 1428 qui évoque un postatus existant dans une maison servant d’auberge et faisant une saillie de quatre pans et demi soit près de 1,10 m sur la rue et que le propriétaire veut détruire pour « à la place des planches construire un mur » (quod postatum vult removere et in loco postium, vult ponere sive construere murum) – c’est-à-dire un mur en maçonnerie (13).
Le mot est,sous diverses graphies, employé en Provence avec ce sens particulier au moins depuis les premières décennies du XIII e siècle (14) et désigne encore une façade en pan de bois au début du XVI e siècle (15). Mais ce qui importe le plus pour notre propos est l’évolution que connaît ce mot autour des années 1430. En effet, à cette époque, à Avignon comme à Aix-en-Provence, nous trouvons mention de la destruction du postatus en planches de plusieurs maisons, remplacé systématiquement par une construction de plâtre avec poteaux de bois désignée comme un postatus de plâtre (postatus de gipo) (16).
Les termes postat ou postatus se trouvent ainsi employés, grosso modo après les années 1430, pour désigner des structures légères de plâtre construites en façade des maisons provençales, et cela jusqu’au début du XVI e siècle. Au-delà de la révision de nos a priori sur l’usage du pan de bois en basse Provence qu’un tel constat engage à mener, il convient de souligner, dans le cadre d’une approche de la construction des maisons à travers les textes, que les mots postat ou postatus, après les années 1430,se présentent un peu comme des fossiles. Leur racine post conserve alors le souvenir d’une technique (le pan de bois en planches) obsolète. Plus que de fossiles, il conviendrait sans doute de parler de vestiges dans un sens presque archéologique du terme ; le vocabulaire demeurant pendant quelques décennies comme un témoin d’un mode de construction révolu.
Un exemple, là encore, ne saurait épuiser le sujet et il faudrait pouvoir aborder entre autres la question de l’origine étrangère des termes techniques, de leur apparition, de leur abandon ou de leur évolution sémantique.
Prétendre proposer une vision exhaustive de cette matière relèverait toutefois d’une douce illusion étant donné le niveau de nos connaissances dans ce domaine. Et la richesse des fonds d’archives méridionaux s’avère être à la fois, dans ce cas, un atout et un handicap en raison de l’ampleur des dépouillements et des traitements à faire subir à la documentation.
Les textes, en résumé, ne se présentent pas comme des sources immédiates, contrairement à ce que la relative simplicité de leur abord peut laisser penser. Et tenter d’appréhender les chantiers des maisons à travers eux nécessite de replacer un discours, apparemment clos sur lui-même, dans l’ensemble plus large de son contexte de production. Si l’on ne peut prétendre se débarrasser de tous les filtres que l’écrit interpose entre le chercheur et le chantier médiéval, il semble néanmoins important – et c’était là le principal objet de la présente contribution – de souligner le fait qu’une partie de nos difficultés provient d’une mauvaise appréhension du propos de nos sources, d’une sollicitation à contre-emploi, et d’un manque d’attention aux nuances de leur langue.
Il n’est pas question, écrivant cela, de s’ériger en censeur car ces défauts – que je partage amplement – sont inhérents au fait que l’approche des techniques par ce type de sources est une discipline à divers égards encore balbutiante ou en formation. Les réflexions proposées veulent s’inscrire dans la dynamique d’une recherche nécessaire sur l’usage archéologique des sources écrites. Ces dernières peuvent encore apporter beaucoup à notre appréhension de la maison médiévale; en nous aidant, notamment, à mieux définir ou à mieux cerner notre objet d’étude.
Qu’est-ce, en effet, qu’une maison pour un habitant du Midi de la France, au Moyen Âge ?
Les lexiques donnent le provençal mayson comme un équivalent du latin domus et traduisent le tout par « maison ». Mais lorsque le rédacteur d’un glossaire provençal-latin composé à Marseille au XVe siècle cherche à rendre le mot mayson, il ne donne pas moins de 20 équivalents:
- domus
- domicula
- domuncula
- habitatio
- aedes
- aedificium
- doma
- domicilium
- aula
- regia
- palatium
- hospitium
- tabulatum
- apogeum
- hypogeum
- geneteum
- pistrinum
- ergastulum
- officina
- fundus
Nous nous trouvons là face à une notion pour le moins complexe qui déborde largement ce que l’on désigne comme le logis. Le prix-fait de 1447 en donne un exemple puisqu’il englobe la boutique dans l’ensemble maison (apotheca domus). Certaines de ces équivalences interrogent, comme intrigue l’apparente distinction faite dans le prix-fait de 1447 entre domus et hospitium. L’un des intérêts majeurs de l’approche par les textes peut être tout simplement, au vu de la manière dont les hommes du Moyen Âge eux-mêmes envisageaient leur habitat, de poser des questions auxquelles des présupposés ne nous permettent pas toujours de penser.